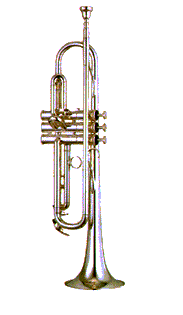Le terme de tuba (trompette en latin) est apparu en 1835, lorsque Wilhelm Wieprecht, chef de musique militaire prussien, mit au point avec le facteur berlinois Moritz un Bass-Tuba en fa, sorte de bugle doté d’un nouveau type de piston appelé Berliner-Pumpe, mieux adapté à la configuration des tuyaux.
Nombreuses étaient en effet les tentatives pour étendre vers les graves la tessiture des cuivres. Le Bass-Tuba représentait donc un progrès considérable. Peu de temps après, Wieprecht et Moritz fabriquèrent un autre tuba en fa, au tuyau encore plus large, qu’ils appelèrent Bombardon, nom donné jusque-là aux ophicléides et aux bugles basses.
Les premiers tubas contrebasses en ut et en si bémol apparurent en Bohême vers 1845. Mais il appartenait à Adolphe Sax – et à ses émules- de développer entre 1840 et 1850, la vaste famille des saxhorns (allant du sopranino à la contrebasse), dont les plus graves sont les prototype de notre tuba moderne.
Toutefois, si le tuba se répandit rapidement en Allemagne, il n’en alla pas de même en France, où le nouvel instrument fut longtemps réservé aux fanfares et formations militaires. L’orchestre symphonique restait par sa part fidèle à l’ophicléide, qui ne fut pas abandonné avant les dernières années du XIXe siècle. Le tuba, pourtant avait eu un fervent adepte en la personne d’Hector Berlioz.
Wagner ne pouvait ignorer les ressources du tuba, qu’il employa pour la première fois dans son Ouverture de Faust (1840). Mais il allait bientôt imaginer, pour L’or du Rhin, un nouvel instrument, sorte d’hybride entre le tuba et le cor baptisé " Wagner-tuba ".
Le tuba aura ensuite une place de choix dans les somptueuses orchestrations de Rimski-Korsakov, de Malher et de Richard Strauss. Après quoi le jazz lui fera subir une roborative cure de jouvence !